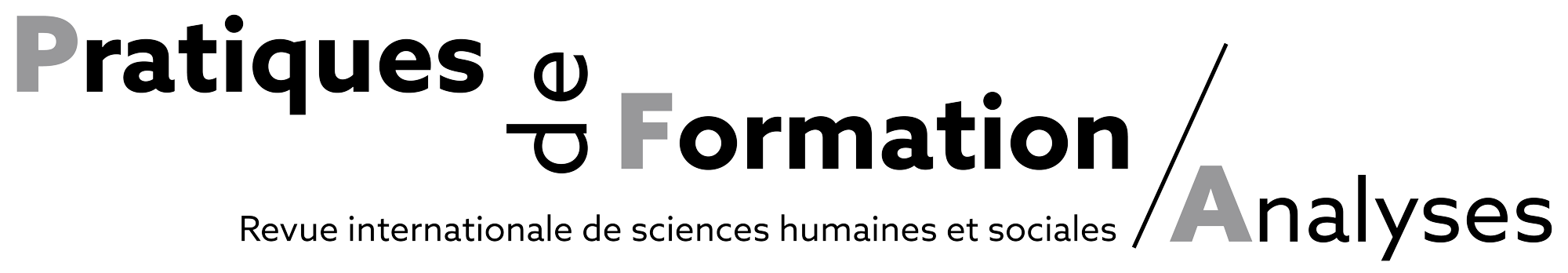Un chantier international de travail volontaire se définit par la réalisation, durant quelques semaines, d’un service d’intérêt général au profit d’une collectivité donnée (association, commune…). Ce service est le plus souvent effectué par l’accomplissement de travaux manuels.
Ainsi, à la différence des autres formes estivales de loisirs juvéniles qui se sont développées au cours du siècle précédent (camps de jeunes, auberges de jeunesse, séjours linguistiques…), les volontaires – terme désignant les jeunes hommes et les jeunes femmes participant à un chantier – travaillent durant une partie de leurs vacances. Ce travail volontaire, plus que bénévole, vient caractériser ce secteur associatif qui se reconnaît dans le concept de volontariat.
Les chantiers ont été reconnus comme un secteur de l’action publique en 1959, quand le tout jeune Haut-Commissariat à la jeunesse et aux sports, prémices d’un ministère de plein droit, fonde Cotravaux, association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes. Cotravaux réunit à sa création, aux côtés de plusieurs ministères, une dizaine d’associations fondées pour la plupart aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Si ces associations ont en commun la pratique du chantier, elles ont des références idéologiques distinctes et des objectifs qui divergent. Autrement dit, elles ne recourent pas au travail manuel pour les mêmes raisons. En puisant dans un travail doctoral sur l’histoire de plusieurs associations de chantiers françaises, je m’interrogerai ainsi sur ce qui pourrait constituer, aux yeux des fondateurs – les femmes sont quasi absentes au départ – une « éducation populaire manuelle ».
Si, à l’instar des autres activités estivales pour la jeunesse, les volontaires forment une « communauté provisoire », au sens qu’Emmanuel Mounier donnait au stage de moniteur·ices de colonies de vacances, le chantier n’est pas seulement une communauté de vie, il est également une communauté de travail. Cette dimension spécifique au chantier fait-elle l’objet d’une réflexion de la part des fondateurs ? Existe-t-il des objectifs éducatifs assignés à cette mise au travail de jeunes ? Dans un secteur de l’éducation populaire qui fait la part belle aux savoirs intellectuels, une pédagogie du travail manuel se dégage-t-elle ?
Après une présentation, sous l’angle du travail, des diverses formes que prennent les chantiers, je m’attacherai à définir la place de ce travail dans la mise en œuvre du chantier en tant qu’activité juvénile estivale, pour terminer sur une exploration et une interrogation autour de la dimension éducative du travail manuel.
Derrière une activité commune, une diversité d’approches
La dizaine d’associations qui se retrouve autour de la table de Cotravaux lors sa fondation est issue de sphères différentes et porte des idéologies parfois opposées : pacifiste intégral pour le Service civil international (SCI), catholique social pour les Compagnons bâtisseurs (CB), héritière des Chantiers de la jeunesse de Vichy pour Concordia, liée au milieu universitaire pour Jeunesse et Reconstruction (JR), à celui de l’artisanat pour les Moulins des apprentis (MA) ou encore aux églises protestantes pour le Mouvement chrétien pour la paix (MCP), etc.1
En tant qu’organisme de cogestion, Cotravaux dispose d’une enveloppe de crédits publics pour financer les actions relevant de son périmètre de compétences. En 1962, un règlement intérieur recensant les critères d’éligibilité d’un chantier aux financements (durée, public, organisation, etc.) est adopté. Si l’effectivité d’un « travail manuel » est un de ces critères, celui-ci n’est pas décliné. Autrement dit, ce travail ne fait pas l’objet d’une réflexion collective, ou du moins d’un consensus, sur sa dimension éducative. Il faut donc regarder du côté des associations et de leurs actions pour en savoir davantage sur ce « travail manuel », ce qui révèle une grande diversité de pratiques2.
Un chantier dure de deux à quatre semaines et la durée consacrée au travail varie de 20 à 45 heures hebdomadaires. Pour les chantiers d’adolescents, seules les matinées sont réservées aux travaux, alors qu’ils peuvent occuper six journées pleines sur certaines opérations pour adultes. On ne travaille donc pas autant d’un chantier à l’autre et d’une association à l’autre. En dehors des moments relevant de la vie quotidienne (repas, toilettes), le reste de l’emploi du temps est consacré à des loisirs individuels ou collectifs. La nature de ces loisirs est significative en soi du projet éducatif de chacune des associations : visites touristiques, débats sur des questions sociales ou géopolitiques, jeux sportifs, découvertes de métiers ou études bibliques ne répondent pas aux mêmes enjeux de formation de la jeunesse. Mais ces différences éducatives se reflètent-elles de la même façon au niveau du travail ? La nature des travaux effectués est-elle différente d’une association à l’autre ?
La grande majorité des chantiers de jeunes s’inscrivent dans le registre des travaux du bâtiment. Dans cette catégorie, arrivent en tête les tâches relevant du gros œuvre : extraction de pierres dans des carrières, nivellement de terrains ou de routes, creusement de fondations pour des bâtiments, coulage de dalle, montage de murs et autres travaux de maçonnerie… Viennent ensuite les travaux de peinture. Les travaux de charpente, de couverture et de menuiserie sont plus rares. L’électricité et la plomberie restent l’exception. Derrière cette grande catégorie des travaux du bâtiment arrivent les travaux forestiers et ceux relevant des « espaces verts » : débroussaillage et autres tailles, dégagement de semis, entretien de chemins forestiers ou de parcs, curage de fossés ou nettoyage de cours d’eau. Ces travaux, qui caractérisent notamment les « chantiers de forestage », ne sont pas sans rappeler les Chantiers de la jeunesse de Vichy, même si les travaux de coupe et de charbonnage ont disparu. Les autres catégories restent marginales : travaux des champs (cueillette, ramassage, fauchage), travaux de fouilles archéologiques, ou « chantiers d’urgence » consistant en des travaux de déblaiement et de nettoyage après des inondations ou des glissements de terrain. Toutes les associations ne proposent pas l’ensemble de ces opérations. Les camps agricoles et les chantiers de forestage sont rejetés par plusieurs d’entre elles en raison de leur faible « utilité sociale ». Mais cette différence relève davantage d’une distinction selon la nature des bénéficiaires, et non selon la nature de la tâche à effectuer ou d’un geste technique qui n’apparaît pas comme un marqueur discriminant entre les associations.
En effet, ce qui caractérise l’ensemble de ces travaux, et ce quelles que soient les associations, c’est leur faible technicité. La grande majorité des travaux relève d’une catégorie professionnelle précise, celle des manœuvres. Ils requièrent un matériel courant et peu onéreux, ce qui donne à ces interventions le qualificatif de chantier « pelle – pioche » ; une pelle que l’une des organisations, le SCI, intègre à son emblème. S’ajoute à ces raisons matérielles la nécessité de proposer un chantier avec un volume de travaux suffisant pour mobiliser une équipe d’au moins une vingtaine de volontaires (et justifier la formation d’une communauté juvénile), ce à quoi le gros œuvre se prête plus facilement. Enfin, ces travaux doivent permettre d’accueillir tout·e jeune motivé·e, même si il ou elle n’est pas expérimenté·e ou qualifié·e. Ce sont donc ces paramètres qui influent sur la nature des tâches proposées et qui expliquent leur transversalité à l’ensemble du secteur.
Cette faible technicité des travaux n’exclut pas leur nécessaire encadrement technique. Aux côtés d’un ou plusieurs cadres en charge de la vie quotidienne (intendance, logistique, loisirs…), un cadre est désigné au suivi des travaux. Dans les premiers temps, ces cadres techniques sont des salariés des organismes bénéficiaires ou sont recrutés auprès d’organismes partenaires. Puis, au cours des années 1950, certaines associations mettent en place des stages de formation de cadres, afin de privilégier une formation interne d’anciens volontaires. Mais la formation technique est rarement présente au programme. Ce volet, qui se limite à un niveau d’initiation, occupe au mieux les après-midi dans un emploi du temps privilégiant la gestion quotidienne et les méthodes d’animation d’un groupe international de jeunes. Pour d’autres associations, la formation technique relève davantage d’un apprentissage par l’expérience, au cours des précédents chantiers d’été ou lors de chantiers de week-end mis en place à destination de leurs militant·es.
Peu présente à travers la formation et non théorisée dans les archives qui nous sont parvenues, est-ce à dire que la dimension éducative du travail relève d’un impensé de la part de ces associations ?
« Travailler, vivre et apprendre ensemble : le triple fondement de la vie des chantiers3 »
Cette formule de présentation du chantier par JR au début des années 1950 fait écho à l’un des principes de la déclaration d’Askov de 1947, que conclut une rencontre internationale d’associations de chantiers pour la paix, rencontre à laquelle participe le SCI. Ces organisations se donnent comme but commun de « construire la paix à l’aide de petits groupes de volontaires internationaux, travaillant, vivant et apprenant ensemble ». Ainsi, le travail ne serait pas un apprentissage en tant que tel, puisque les deux notions sont énoncées séparément. L’« apprendre » ne serait pas une conséquence du « travailler », mais constituerait un temps spécifique dans le déroulé du chantier. Ce serait donc les loisirs qui constituent ce temps éducatif (visites touristiques, temps d’échanges interculturels, conférences, veillées…).
Le temps dédié au travail contribuerait néanmoins à une démarche globale d’éducation : « Ils ne se connaissaient pas, ils ont vécu quinze jours ensemble et ils sont devenus des frères dans le travail et le repos4 » déclare le fondateur des Moulins des apprentis. Le travail permettrait ainsi d’apprendre sur soi et sur les autres, contribuant à la formation d’une communauté provisoire. « Bâtir, c’est unir ! » devient la devise de cette association issue du monde de l’artisanat pour qui « le travail renferme en soi beaucoup de vertus, celles sans doute de rallier les hommes dans un climat de concorde, d’amour et de paix5 ». Le travail se fait allégorie de l’apprentissage d’un vivre-ensemble et de la construction d’un monde de paix. « Un monde tout nouveau vaillamment bâtissons ! » chantent ainsi les Compagnons bâtisseurs. Le travail rendrait ainsi les volontaires acteurs de changement, en construisant un monde de paix par la constitution de multiples communautés internationales de jeunes, provisoires et estivales.
Les chantiers s’inscrivent dans le temps des vacances. Mais les associations refusent d’être associées, ou réduites, à des organismes de vacances pour la jeunesse. Elles cherchent ainsi à se démarquer en usant de formules (« Des vacances… peut-être, mais utiles6 ») ou de qualificatifs (« des vacances pour leur formation sociale7 »). Le travail serait ainsi un élément de distinction positif par rapport à d’autres offres de vacances, et le chantier s’inscrirait dans la catégorie des « vacances au travail8 ». Certaines associations mettent également en avant leur engagement en faveur d’une accessibilité aux vacances pour une partie de la jeunesse qui en est privée pour des raisons économiques. Travailler permettrait « à des jeunes sans moyen de fortune de trouver une solution au problème de leurs vacances9 ». Le travail apparaît alors comme une condition au départ en vacances ─ la valeur produite par ce travail (coût payé par le bénéficiaire) permet de réduire le coût du séjour10 ─ et à l’accès à des contreparties : hébergement, nourriture, loisirs et visites touristiques, loisirs que des associations qualifient de « récompense du travail11 ». Certaines associations (JR, Concordia) mettront même en place l’attribution d’un « pécule », pour l’ensemble des volontaires sur les camps agricoles ou sur des chantiers où les travaux sont plus durs. Mais dans certains cas, il est « fonction du travail fourni et du comportement12 ». Cette pratique, qui disparaît au tournant des années 1960, est rejetée par les autres associations pour qui le travail est soit le moyen de faire acte de solidarité envers une collectivité donnée, soit une contrepartie nécessaire au départ en vacances, un départ qui pour nombre de volontaires, est synonyme de départ à l’étranger.
Travail manuel et rencontre internationale sont deux découvertes pour la plupart des volontaires, mais la seconde est davantage pensée dans sa dimension éducative. La rencontre de jeunes d’autres pays répond ainsi à « ce besoin latent d’aventure13 » qui caractérise la jeunesse, elle est source d’un « enrichissement culturel [voire d’un] bouleversement psychologique14 ». Pour préparer les volontaires à celui-ci, certaines associations mettent en place la règle du home service car « les étudiants français qui participent à des chantiers à l’étranger manquent d’expérience et ne donnent pas toujours satisfaction aux organisateurs de chantiers15 ». Aussi, une confrontation à une communauté internationale dans son propre pays est demandée avant de franchir les frontières, afin que cette nouvelle expérience soit positive, pour l’organisme d’accueil comme pour le volontaire. Ainsi, la rencontre internationale est pensée comme une expérience formatrice, parce que nouvelle. Il pourrait en être de même pour un travail manuel que découvrent des étudiant·es mais, quand ce travail est évoqué, il est présenté comme favorisant cette rencontre internationale et non comme une expérience nouvelle et formatrice en soi. Any O’Lanyer, une jeune cadre des CB, indique que le chantier est « un moyen intelligent de faire du tourisme » et elle invite les jeunes volontaires à « ne pas considérer la région […] comme un musée à visiter, mais [à] travailler dans le cadre offert par cette région, [à] entrer en contact avec les gens du pays en travaillant avec eux ». Le chantier permet un « contact réel, l’homme s’exprimant plus dans son travail, s’il est librement consenti, que dans ses loisirs où il s’évade plus qu’il ne s’exprime16 ».
Ce témoignage d’une jeune militante replace le travail dans une fonction d’éducation à l’altérité, reposant sur une rencontre par le geste davantage que par la parole, qui est pour nombre de jeunes de cette époque une barrière. Le chantier se démarque ainsi des camps internationaux, réservés aux seuls jeunes polyglottes. Le travail favoriserait ainsi une éducation à l’interculturalité. Mais ce témoignage reste exceptionnel et la portée éducative de cette dimension interculturelle n’est pas développée par les organisations. Elle ne s’inscrit pas dans une démarche de formation réfléchie, conceptualisée, qui débuterait avec une préparation au départ et à la rencontre, et se conclurait par un travail d’analyse collective et partagée de l’expérience vécue. La rencontre porterait en elle une spontanéité éducative, que le travail faciliterait en réunissant des jeunes de différents pays autour d’un objectif partagé.
Accessible à tous et bientôt à toutes, permettant le départ en vacances, finançant des contreparties offertes aux volontaires, le travail semble surtout conçu comme un moyen de constituer une communauté juvénile internationale. Il favoriserait ainsi la rencontre entre jeunes de différentes origines, provenances, nationalités, contribuant ainsi à une éducation à l’altérité, au même titre que la vie en communauté et que les loisirs partagés, qui apparaissent comme le temps dédié aux apprentissages. Ce travail manuel est-il pour autant dénué de portée éducative en soi ?
Le travail comme indicateur d’une priorité donnée à l’éducation ou au service
Au sein du secteur des chantiers, une ligne de séparation se dessine entre les associations mettant l’accent sur la dimension éducative du chantier (Concordia, JR, MA), et celles priorisant la réalisation d’un service (SCI, CB, MCP).
Au sein du premier groupe, les futurs adultes à former ne sont pas les mêmes. Les Moulins des apprentis, et c’est une spécificité au sein de ce secteur, accueillent majoritairement de jeunes travailleurs manuels, dont l’inscription au chantier est prise en charge par les chambres des métiers. Le rapport au travail manuel est donc différent pour cette association qui s’inscrit dans la vision de l’apprentissage défendue par ces chambres des métiers : « l’apprenti ne [vend] pas son travail contre un salaire, il le [négocie] contre une éducation17. » Le travail effectué sur un chantier est donc aux fondements de l’éducation que les jeunes volontaires recevront sur le chantier, à travers des vacances collectives auxquelles peu d’entre eux ont alors accès.
De leurs côtés, si Concordia et JR s’adressent en principe à l’ensemble de la jeunesse, leurs publics sont à 90 % étudiant, une future élite qu’elles entendent contribuer à former. Si JR développe peu d’arguments autour d’une dimension éducative d’un travail manuel, il n’en est pas de même à Concordia. Pour son public majoritairement étudiant, elle propose un travail manuel qui « est une activité nouvelle pour la plupart [et qui ne peut être qu’] enrichissante18 ». Associé à une vie « en plein air » qui leur permettra de recevoir « les toniques naturels dont [leur santé] aura besoin pour passer l’hiver19 », cette expérience de « mise au vert20 » vise à sortir la jeunesse de l’école en lui fournissant un travail manuel, qui « a par lui-même une incontestable valeur de regroupement moral et de régénération21 », un concept de régénération qui sous-entend les carences d’une école trop livresque. Aussi, peu importe la nature des travaux et des bénéficiaires et si ces camps sont isolés et repliés sur eux-mêmes, comme dans le cas des chantiers de forestage, la portée éducative n’en sera que plus forte. Concordia s’inscrit dans la lignée des Chantiers de la jeunesse française (CJF) dont le projet éducatif comprend notamment « le développement de l’habilité technique à travers l’apprentissage de différentes techniques22 ». Tout comme sur les CJF, le travail est renvoyé à sa fonction éducative et il ne peut être une finalité en soi. Concordia critique les chantiers où « l’objectif principal est la rentabilité, sans souci éducatif23 ». Le service n’est au final qu’une des dimensions constitutives d’un projet de formation globale, à la fois morale et physique, auquel contribue le travail manuel.
À l’opposé de ce modèle, celui porté par les CB et le SCI qui considèrent que tout chantier doit reposer sur « un travail utile et désintéressé24 », offert à une collectivité dans le besoin (populations sinistrées, réfugiées ou victimes d’injustices sociales). Cette finalité première ne signifie pas qu’il n’est pas assigné au chantier des objectifs éducatifs, mais ceux-ci reposent sur une transmission de valeurs humanistes, une éducation à l’altérité ou encore des débats sur des questions de société. Les chantiers du SCI ne sont pas des communautés éducatives de jeunes, ils sont des communautés de travail au service de populations dans le besoin. Aussi, la mission première d’un cadre n’est pas d’animer un groupe de jeunes, elle est de « permettre un rendement de travail maximum ». Entre éduquer et servir, le SCI a choisi : hors de question « de faire du scoutisme pour adultes25 », les volontaires viennent pour « se mettre à la disposition du SCI […] et non pour passer des vacances et faire une expérience humaine26 ».
Pour autant, le travail n’est pas une finalité en soi. Il n’est que le moyen de porter un message ou, pour reprendre le terme usité par ces associations, un témoignage. Qu’il s’agisse de témoigner en faveur de la paix (SCI, MCP) ou de leur foi (CB, MCP), le comportement des volontaires se doit d’être exemplaire. Pour les CB : « La qualité de notre témoignage [passe par] la qualité technique de notre travail. » La productivité du travail et « l’esprit dans lequel ils doivent l’accomplir27 » deviennent en soi des actes éducatifs, non pour les volontaires, mais pour les bénéficiaires et, par extension, pour les populations alentour qui sont témoins de cet acte de solidarité. Pour le SCI, un chantier porte une valeur démonstrative de ce que pourrait être un service civil alternatif au service militaire et se doit d’être témoignage concret d’un monde de paix, d’amitié et d’entraide.
Sur ces chantiers, la rencontre avec les bénéficiaires des chantiers prime sur la rencontre entre jeunes volontaires et ces organisations développent une modalité d’intervention dépassant le « travailler ensemble » des communautés juvéniles pour le « travailler avec » les bénéficiaires, et former ce que les CB nomment une « communauté de destin28 ». « Pendant trois semaines, [le volontaire] va entrer dans la souffrance des autres, vivre au milieu d’eux, s’ajouter à eux pour essayer de se défendre avec eux contre la misère. Avec eux il prendra la pelle et la pioche, il creusera la terre, élèvera des murs, se blessera les mains, se fatiguera les bras et les reins. Avec eux, il ne perdra pas une minute, car il est pressé d’aboutir. Il n’y a plus alors sur le chantier de riches qui secourent des pauvres, il y a des hommes qui ensemble luttent avec acharnement contre la misère29. » Cette volonté de partager des conditions de vie et de travail, c’est aussi une manière, selon le SCI, de « faire renaître l’espoir et l’initiative dans l’esprit de chacun30 », et de permettre aux communautés de poursuivre la dynamique enclenchée par le chantier.
Le travail manuel au service d’une société réconciliée ?
Ainsi, pour ces associations, les volontaires ne sont pas uniquement des jeunes à éduquer, ils peuvent également se faire éducateurs par leur engagement sur les chantiers, par l’exemple qu’ils montrent aux bénéficiaires à travers un travail physique qui n’est pas le leur, par ce témoignage d’entraide qu’ils affichent aux yeux de tous31. La dimension éducative du travail manuel serait donc ici toute autre. Elle n’est pas pour autant formalisée dans le discours de ces associations. Pourtant, c’est bien par le travail manuel que les volontaires deviennent les acteurs d’un service. « Respectons nos outils, […] car ce sont nos moyens d’expression32 » sonne comme un slogan ; c’est par la pelle et par la pioche que les volontaires témoignent des valeurs qui les animent. C’est par le service que les associations valorisent par là même un travail manuel. Sur les chantiers, les jeunes intellectuels expérimentent le travail physique, salissant et répétitif, car ils sont souvent relégués aux travaux de force, ils éprouvent la condition de manœuvre. À travers cette expérience, ils et elles illustrent ce temps des vacances en tant que temps de « rupture33 » dans les « rôles sociaux34 », temps durant lequel certain·es recherchent une « source de fatigue [et non] une cure de repos35 ». Le chantier répondrait alors à cette aspiration de jeunes étudiants cherchant à vivre l’expérience du travail manuel, et à celle de jeunes femmes souhaitant expérimenter une activité masculine et virile.
Le chantier inverse les rôles : les travailleurs manuels détiennent un savoir que n’ont pas les travailleurs intellectuels. Ils sont ceux qui savent, occupent les places de cadres techniques ou sont identifiés comme des personnes-ressources par leurs camarades. Les associations sont à leur recherche et certaines adaptent l’organisation des chantiers en fonction de leurs disponibilités. Cette place particulière, qu’occupent les travailleurs manuels, participe de la rencontre de l’autre et de sa découverte, invitant les intellectuels à porter un regard différent sur les manuels. En février 1957, une association britannique vient solliciter des Moulins des apprentis l’envoi de deux jeunes, un maçon et un charpentier, afin d’encadrer son chantier de reconstruction d’un village sinistré après les inondations ayant frappé les Pays-Bas. Les deux jeunes se retrouvent désignés cadres techniques d’une équipe d’une centaine d’étudiants britanniques. « Ils sont revenus avec une idée toute différente de leur état. Bien sûr, il n’y a pas de sot métier, mais ils étaient tout de même un peu intimidés devant les « intellectuels ». Là-bas, ils ont compris que les charpentiers et les maçons sont aussi nécessaires que les instituteurs et les professeurs36. » Sur les chantiers, les jeunes travailleurs manuels peuvent ainsi se trouver valorisés par celles et ceux qu’ils croyaient être socialement supérieur·es.
« Il est vrai que les professionnels ont raillé le projet des organisations populaires de jeunesse yougoslaves quand celles-ci ont proposé en 1946 de faire construire une ligne de chemin de fer par des volontaires. Cependant, force leur a été de rencontrer qu’avec l’enthousiasme et une bonne direction, des volontaires non qualifiés peuvent accomplir un travail de spécialistes37. » Le Manuel des chantiers de l’Unesco se fait le relais de cette utopie des chantiers qu’il n’est pas seulement de dépasser les frontières, les nationalités et les religions, facteurs de division entre les personnes, mais également le clivage entre travailleurs et travailleuses intellectuel·es et manuel·es. Le travail contribuerait ainsi à éduquer à un rapprochement entre classes, facteur de concorde nationale pour les uns, de justice sociale pour les autres.
Quelle que soit la priorité donnée au chantier, ce n’est pas le travail manuel en lui-même qui est perçu comme éducatif. Il est davantage considéré comme un moyen permettant la réalisation d’un service ou la formation d’une communauté juvénile : accessible à tous, et bientôt à toutes, dépassant les barrières de la langue et des conditions sociales, apportant une aide concrète à des populations, finançant le départ en vacances, etc. Sa dimension éducative n’est pas conscientisée par les associations ; elle peut apparaître ici et là, à demi-mot, du moins dans les archives que ces dernières nous ont laissées. Contrairement à d’autres dimensions constitutives du chantier (loisirs, internationalisme, mixité des équipes, etc.), le travail manuel apparaît davantage comme un impensé éducatif.
Le geste technique comme apprentissage est donc absent du discours des associations lors de leur fondation et durant les premières années. Émergent par contre l’idée du « travailler ensemble », comme vecteur d’une communauté interne, et celle du « travailler avec », comme ferment d’une communauté de destin, dépassant les clivages nationaux et sociaux. Ces deux démarches éducatives dessinent deux entités distinctes, celle des volontaires et celle des bénéficiaires, et renvoient aux deux dimensions de l’éducation populaire : celle de la promotion individuelle, et celle de la transformation sociale.