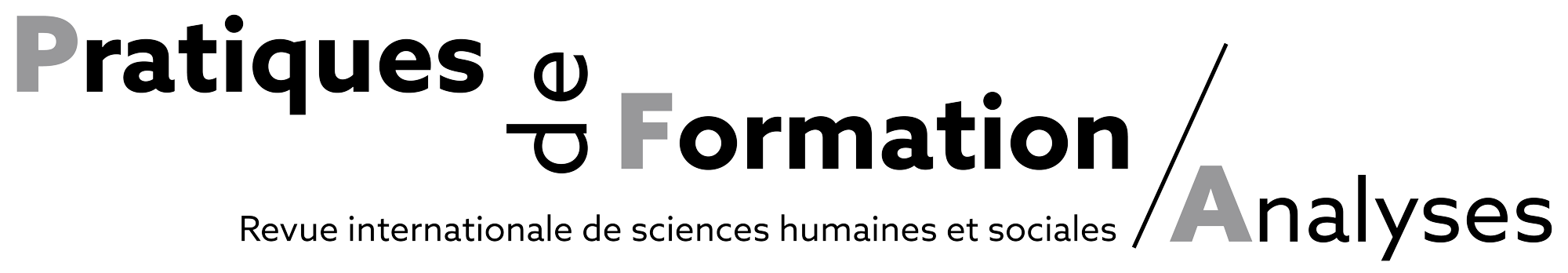L’histoire de la formation technique et professionnelle est un sujet toujours complexe à appréhender. L’évolution, et surtout la disparition, de structures de formations et les mouvements dans la hiérarchie des diplômes, rendent la lecture de cette histoire parfois difficile. Les évolutions socio-économiques sont également à prendre en compte pour comprendre les stratégies scolaires, les intentions politiques ainsi que les luttes internes à certains milieux. Cyrille Bock revient dans Animation socioculturelle. Une histoire de la formation (2024), sur l’histoire des diplômes d’animateurs. Il aborde de manière originale l’histoire de l’animation. Partir de la formation lui permet de saisir d’autres enjeux que ceux liés à l’histoire des idées, notamment les enjeux politiques qui dépassent le monde de l’animation, mais l’impactent indéniablement.
Ce livre, préfacé par Francis Lebon, est composé de quatre chapitres, qui sont les bornes chronologiques du sujet : la période qui précède 1945 est celle où l’animation est une création politique. La période des trente glorieuses, de 1945 à 1978, correspond à la naissance de l’animation socioculturelle avec un développement des associations, des mouvements sociaux, soutenus par l’État, et l’apparition des premiers diplômes de l’animation. De 1979 à 2000, est quant à elle la période de structuration d’un métier, avec de nouvelles préoccupations pour la jeunesse (et surtout la délinquance) de la part des pouvoirs publics, modifiant ce que ces derniers attendent des animateurs, et donc le contenu des diplômes. Enfin, la période de 2001 à 2022, qui marque la fin de l’étude, souligne l’importance croissante des compétences dans la conception et l’évaluation des formations, y compris dans le monde de l’animation.
Avant 1945, un ensemble de préoccupations sociétales conduisent à la création de colonies de vacances et d’un monde de l’animation qui prend en charge la jeunesse. Ce sont d’abord des préoccupations hygiénistes, avec l’idée que le sport doit permettre au peuple d’être plus fort, dans un contexte de guerre. C’est également l’acquisition de nouveaux droits sociaux, sous le Front populaire, qui pousse à repenser l’utilisation du temps libre. La morale n’est pas absente de cette préoccupation puisque l’objectif est d’apprendre au peuple à se servir du nouveau temps dont il dispose : le temps des loisirs. L’augmentation du nombre de colonies de vacances entre la fin du xixe siècle et 1945 implique un besoin croissant d’animateurs, mais aussi la nécessité de les former. En 1937 sont créés les Ceméa (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active). Les différents mouvements (confessionnels et laïques) sont en concurrence pour prendre en charge le temps libre des enfants.
Entre 1945 et 1978, différents bouleversements sociaux impliquent de repenser la place de l’animation et des animateurs. L’obligation scolaire est étendue à 16 ans en 1959, ce qui entraîne une modification de la conception de l’âge de la jeunesse. La situation économique, relativement prospère dans le pays, permet une banalisation, au moins pour certaines classes sociales, du loisir, qui va aussi avec le développement d’équipements de proximité dans le contexte de l’urbanisation. Avec Maurice Herzog, haut-commissaire de 1958 à 1963 puis secrétaire d’État de 1963 à 1966, les pouvoirs publics réinvestissent la question du temps libre, qui était jusqu’alors prise en charge par des associations. Celui-ci crée le fonds de coopération de jeunesse et d’éducation populaire (Fonjep) qui permet une cogestion de l’État et du monde associatif. Toutefois, le rapport à la jeunesse change dans les années 1970, avec une vision plus d’encadrement que de loisirs. L’apparition du chômage des jeunes à cette période en fait une population cible des politiques publiques, ainsi que le développement de groupes comme les blousons noirs. L’animation se dépolitise progressivement. La prise en charge de la jeunesse se fait par les MJC (maison des jeunes et de la culture. C’est également le moment où, par les diplômes, l’animation professionnelle est différenciée de l’animation occasionnelle. En 1967 est créé le diplôme universitaire de technologie (DUT) carrières sociales, qui signe l’entrée de l’animation dans l’enseignement supérieur.
La période suivante, qui s’étend jusqu’à la fin du xxe siècle, débute dans un contexte de tension. L’auteur évoque l’été des Minguettes, nom donné à un ensemble d’affrontements, au cours du mois de juillet 1981, entre les jeunes de ce quartier – situé à Vénissieux – et la police. Les jeunes manifestent à travers ces violences leur infortune qu’ils voient comme le fruit du chômage. Dans la période précédente on observe un développement de l’animation à travers la création d’infrastructures, cette volonté de rapprocher les animateurs de la jeunesse semble trouver en partie ses limites dans ce sentiment d’isolement que vivent les jeunes. La question qui se développe face à la montée du chômage est bien celle de l’insertion professionnelle, et le domaine jeunesse et sports peine à trouver sa place. Le loisir occupe une place croissante dans le budget des familles, les pratiques sportives se développent également. Il se produit alors un éloignement de l’animation du monde de l’éducation populaire. Le besoin d’animateurs est évident et leur nombre ne fait qu’augmenter à cette période. Les formations se développent, témoignant d’une professionnalisation du métier. L’auteur décrit comment une filière se structure à travers la création d’un ensemble de diplômes : brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien (BAPAAT) au niveau du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), brevet d’État français d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) au niveau baccalauréat, diplôme d’État de directeur de projet d’animation et de développement (DEDPAD) au niveau bac + 4, mais le diplôme de référence est alors le diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation (DEFA) qui est équivalent à un niveau bac + 2 ou 3. Ce dernier correspond alors à la logique de l’époque de coopération entre le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et celui des Affaires Sociales. Toutefois, le DEFA est long à obtenir et bien souvent les animateurs qui le suivent ne le terminent pas. Les diplômes qui se développent cherchent à valoriser tant les apports théoriques que les expériences pratiques des animateurs. En 1999 sont créées les licences professionnelles qui témoignent également d’une universitarisation de l’animation, symbole de la professionnalisation. La volonté de structurer le monde de l’animation, qui est portée à la fois par les associations et l’État, illustre surtout une envie de techniciser la profession, dans un contexte de conflit entre l’État et les jeunes.
Le dernier chapitre, qui couvre le xxie siècle, traite plus spécialement du processus de Bologne (mécanisme visant à rendre cohérents les systèmes d’enseignements supérieurs européens, notamment dans le but de faciliter la mobilité des étudiants) et de l’approche par compétences. L’animation n’échappe pas à l’harmonisation qu’implique ce processus européen, ainsi les formations professionnelles doivent être repensées selon l’approche par compétences, et les formations de l’enseignement supérieur doivent être organisées selon le schéma Licence-Master-Doctorat. L’État se retire, à cette période, de l’animation, qui s’inscrit dans un niveau plus local. La hiérarchisation des diplômes d’animateur professionnel (contrôlé plus par des organismes privés que par l’État) participe à la division du travail. Deux filières se structurent, celles des formations jeunesse et sports et celles des acteurs publics, bien que des ponts existent entre les deux, notamment avec la possibilité de double diplomation. Le diplôme de référence n’est alors plus le DEFA, mais le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) qui correspond à un niveau baccalauréat. D’autres diplômes gérés par le ministère des Sports sont créés à niveaux équivalents du CAP, bac + 2 et bac + 3 ou 4, alors que du côté de l’enseignement supérieur se développent les DUT, les bachelors universitaires de technologie (BUT), les licences professionnelles et les masters (de sciences de l’éducation et de la formation).
Finalement, étudier les diplômes permet à C. Bock de saisir à la fois la manière dont est pensé le métier d’animateur, dont sont hiérarchisées, à travers le temps, l’animation professionnelle et occasionnelle, mais aussi quelles sont les attentes politiques envers les animateurs, quels sont les rapports entre les différents ministères, les besoins d’encadrement, d’accompagnement, quelles sont les différentes conceptions de la jeunesse, des loisirs et des sports. C’est aussi un moyen de voir l’évolution de la conception de la formation, la place laissée à la pratique, l’évolution de la légitimité de certains diplômes, de l’importance du monde scolaire, du militantisme, de l’universitarisation, de la professionnalisation, puis progressivement de l’importance prise par l’approche par compétences, qui favorise la hiérarchisation et la normalisation des formations. Les évolutions militantes et sociales transparaissent dans ce livre dont on aurait aimé parfois plus de pages, pour rentrer dans la complexité des évolutions politiques et idéologiques. De même, on peut s’interroger sur le lien entre les différentes formations et les publics ciblés. C’est une synthèse de l’évolution des diplômes qui donne, notamment grâce aux tableaux récapitulatifs à la fin des chapitres, la possibilité d’un coup d’œil rapide sur une histoire longue et complexe.