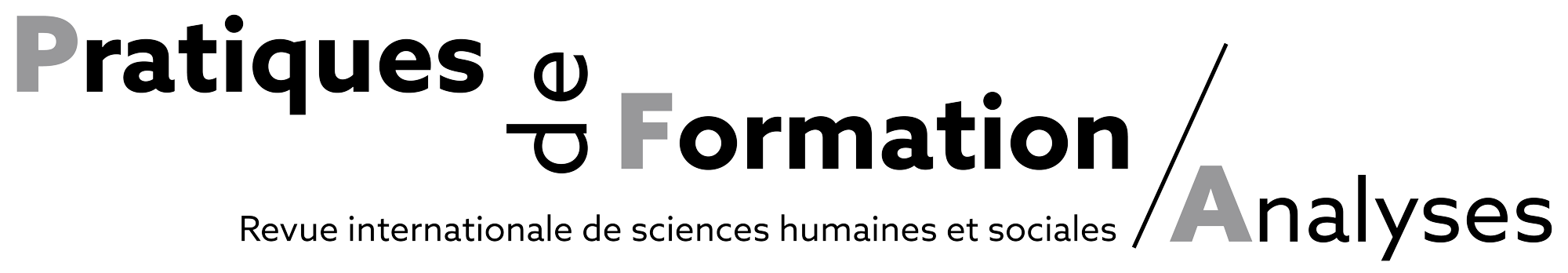Isabelle Collet est sociologue, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Genève, où elle dirige l’équipe G-RIRE : Genre – rapports intersectionnels, relation éducative. Informaticienne scientifique de formation initiale, elle a soutenu en 2005 un doctorat en sciences de l’éducation à l’université Nanterre La Défense sur « La masculinisation des études d’informatique », pour laquelle elle a obtenu un prix de l’Académie des sciences morales et politiques. Depuis 20 ans, ses recherches portent sur les questions de genre en éducation, plus particulièrement en informatique. En 2012, elle a fondé l’ARGEF, l’association de recherche sur le genre en éducation et formation et codirige avec Sigolène Couchot-Schiex la revue GEF (genre en éducation et formation : https://www.revuegef.org/). Elle est également membre du Haut Conseil à l’égalité en France.
Françoise F. Laot. Pourquoi, selon toi, n’est-il plus possible aujourd’hui de faire l’impasse sur une analyse de genre lorsque l’on aborde la question de la culture technique ?
Isabelle Collet. Je pense qu’il n’est plus possible de faire l’impasse sur une analyse de genre, quel que soit le domaine abordé. Pendant longtemps, le masculin a été considéré comme général et le féminin comme particulier. En tant que « particulier », il n’était parfois même pas pris en compte. Depuis les années 1970, avec la vague des mouvements féministes, les femmes dans la recherche scientifique ont contesté cette prédominance de l’angle soi-disant universel, mais en réalité masculin. Les femmes ont pris leur place dans la recherche et ont commencé à traiter des questions les concernant. Cependant, notamment dans le domaine du numérique il persiste cette idée que les femmes représentent un sexe spécifique à étudier en relation avec un « universel » masculin. Or, la manière dont les hommes ont pensé le numérique n’a rien d’universel. Elle reflète leur socialisation, leurs attentes et leurs aspirations tout en renforçant leur position dominante.
Par ailleurs, si les hommes se sont appropriés le numérique, c’est aussi parce que c’est un outil de pouvoir. Quand un champ de savoir prend de la valeur dans la société, le groupe dominant s’en empare… ce qui renforce la place de ce champ de savoir, puisque ce sont les dominants qui l’exercent ! C’est ce qui s’est passé avec le numérique. Ainsi, dans le domaine du numérique comme dans la société en général, ni les hommes ni les femmes ne sont des entités neutres ou universelles. Donc, si l’on veut comprendre un fait social, notamment en termes de rapports de pouvoir, il est indispensable de l’aborder sous l’angle du genre. Ce qui signifie, y compris, étudier les hommes.
Françoise F. Laot. Pourrions-nous revenir sur cette question du numérique masculin qui n’est pas neutre ?
Isabelle Collet. Lorsque je parle de numérique, je fais surtout référence à l’informatique, qui n’est pas, évidemment, tout le numérique. Il faudrait définir ce que l’on entend par « numérique » : les usages, les outils, et la maîtrise des outils et des concepts. Personnellement, je me suis intéressée plus spécifiquement à l’expertise dans le domaine numérique, ce que l’on appelle aujourd’hui la science informatique. Autrefois, on disait simplement « informatique ». Cette science, lorsqu’elle a été conçue, a été imaginée par des ingénieurs qui portaient des fantasmes à l’origine de la construction des machines typiquement masculins d’auto-engendrement.
Si l’on regarde les écrits de ceux que l’on peut appeler les « pères » de l’ordinateur, comme Alan Turing ou John von Neumann, on remarque des ambitions très marquées. À l’époque où ils travaillaient, on était juste après la Deuxième Guerre mondiale et ils n’avaient pas les moyens techniques de leurs ambitions, mais déjà, ce qu’ils cherchaient à réaliser, c’était l’intelligence artificielle, qui n’est donc absolument pas quelque chose de récent, même si c’est très à la mode depuis peu, notamment parce que cela fonctionne !
John von Neumann considérait que l’aboutissement ultime de la science serait de modéliser et de dupliquer le cerveau humain, et plus précisément le sien, qu’il estimait d’une intelligence supérieure. Selon lui, la mémoire était le centre de l’intelligence, ce qui le poussa à vouloir doter les ordinateurs d’une mémoire aussi vaste que possible. Il jugeait que le tube à vide était le composant électrique le plus proche du neurone, qu’il cherchait à reproduire, et supposait que le cerveau fonctionnait de manière séquentielle. Il écrivait : « Probablement, les ordinateurs seraient plus efficaces en parallèle, mais comme le cerveau fonctionne en séquentiel, je vais faire fonctionner mon ordinateur en séquentiel. » Cette conviction influença ses choix techniques, notamment l’adoption d’une architecture séquentielle pour les ordinateurs.
Quand Turing travaille sur le jeu de l’imitation, il cherche à déterminer si les ordinateurs peuvent être considérés comme intelligents. Lorsqu’il définit ce qu’est une machine intelligente, il s’interroge sur sa création et il estime qu’une telle machine devrait être conçue par un groupe d’ingénieurs tous du même sexe. Autrement, on pourrait se demander s’il n’y aurait pas une reproduction sexuée dans le processus. Il est évident que Turing ne s’imaginait pas un groupe de femmes produisant un ordinateur. Ainsi, lui aussi cherchait à créer un être informationnel, et cette notion d’être informationnel vient d’un autre père de l’ordinateur, ou au moins de la cybernétique, Norbert Wiener. Pour Turing, cet être informationnel devait nécessairement être masculin, car il ne pensait pas que l’intelligence des femmes permettrait de produire un locuteur véritablement intéressant.
En résumé, un groupe d’informaticiens, de cybernéticiens, de mathématiciens et de logiciens poursuivait le projet de développer l’intelligence artificielle dans les années 1945-1950. Cette intelligence artificielle était censée être strictement informationnelle, et leur modèle était leur propre cerveau, ou plus précisément, les cerveaux des hommes. De cette époque-là, il reste des fantasmes et des représentations de l’ordinateur et de l’intelligence artificielle, réactivées aujourd’hui à grande échelle, puisque l’intelligence artificielle est devenue très populaire. Elle persiste aussi dans de nombreuses dimensions du numérique, avec des objets concrets qui ne sont pas conçus en pensant aux femmes.
Prenons l’exemple classique du téléphone portable : les téléphones Apple sont trop grands pour les mains des femmes, et c’est intentionnel. Ils ont été modélisés selon la taille moyenne des mains des hommes. Ainsi, pour une main comme la mienne, il m’est impossible de tenir mon téléphone portable et de prendre une photo en même temps, c’est trop grand. Pourtant, autant d’hommes que de femmes possèdent des téléphones. Ce n’est pas la première fois qu’Apple est pris en flagrant délit de concevoir des objets pour les hommes et pas pour les femmes. Par exemple, lors de l’introduction du paiement par carte bancaire via Apple, les femmes étaient systématiquement plafonnées à un montant plus bas que les hommes, indépendamment de leur salaire. Il y a donc une conception qui, bien que non malveillante, est parfois inconsciente ou automatisée, optimisant certains objets technologiques pour les hommes, plutôt que pour les femmes.
Un autre exemple concerne la reconnaissance vocale. C’est une technologie stratégique dans de nombreux domaines. Actuellement, la reconnaissance vocale fonctionne mieux pour les voix d’hommes que pour celles de femmes. Par conséquent, si un assistant vocal ne comprend pas ce que tu dis, par exemple dans le cas des répondeurs téléphoniques, ce n’est pas toi qui n’es pas doué avec lui, mais lui qui n’est pas adapté à ta voix.
Il y a des enjeux, par exemple, très importants dans le domaine du maintien à domicile des personnes âgées. Par exemple, imaginons qu’une personne âgée appelle au secours et qu’une IA soit censée reconnaître cet appel et appeler une ambulance. Il est essentiel que cette technologie fonctionne parfaitement. Or, les voix des personnes âgées, en particulier des femmes, sont souvent mal reconnues. Cela provient des bases de données d’entraînement des IA, qui contiennent principalement des voix d’hommes, ou de personnes jeunes issues de corpus qui viennent de la presse audiovisuelle, où les voix masculines sont beaucoup plus représentées. Non seulement il faudrait rééquilibrer les données pour créer des corpus avec des voix féminines et masculines de manière équitable, mais il faudrait en plus réentraîner les algorithmes de reconnaissance vocale avec ces nouveaux corpus, car ceux-ci ont été optimisés pendant des années avec des voix plutôt graves et de faible amplitude.
Il est impossible de comprendre le numérique, l’informatique ou la technologie aujourd’hui sans prendre en compte cette homogénéité des personnes qui ont conçu ces systèmes.
On peut citer d’autres exemples. La personne qui a conçu la ceinture de sécurité n’a jamais eu de poitrine. Sinon, on aurait un système qui se clipserait différemment. Ces ceintures ont été pensées pour des hommes, sous l’hypothèse implicite qu’ils seraient les seuls à conduire. Cela fait des décennies que les ceintures existent, et pourtant, toutes les femmes ont des remarques à leur sujet.
Françoise F. Laot. Nous sommes vraiment au cœur du sujet, avec une technologie qui agit sur nos vies au quotidien.
Isabelle Collet. La technologie peut même agir contre les femmes. Prenons l’exemple des logiciels qui monitorent les cycles menstruels. Au début, les téléphones portables ont été équipés d’applications de santé qui suivaient des informations comme le poids, la taille, le rythme cardiaque, le nombre de pas, la pression sanguine, entre autres. Mais les règles n’étaient pas prises en compte. Dans l’esprit des programmeurs, les menstruations étaient un sujet auquel ils ne pensaient même pas, voire qui les répugnait, ils ne les ont pas intégrées. Pourtant, les cycles menstruels sont un paramètre pertinent à surveiller, d’une part pour être ou ne pas être enceinte, mais aussi parce qu’ils influencent les performances sportives, un facteur important pour les femmes athlètes mais aussi toutes les femmes qui font du sport. Encore aujourd’hui, les applications de coaching sportif intègrent un bon nombre de vos données personnelles mais ont pour modèle de référence un corps d’homme.
Au fil du temps, toutes les applications de santé ont commencé à intégrer les cycles menstruels, et des applications spécifiquement dédiées au suivi de ces cycles ont vu le jour. Cependant, lorsque les États du sud des États-Unis ont modifié leur législation sur l’avortement, certaines de ces applications ont pris la décision de « sauvegarder leurs données en Europe ». Elles ne voulaient pas que les informations sur les cycles menstruels puissent être utilisées pour savoir si une femme avait avorté, ce qui aurait pu être déduit à partir de ces données. Toutes les applications n’ont pas adopté cette démarche. Google, par exemple, qui suit les déplacements de tout le monde, a annoncé qu’il supprimerait les données relatives aux zones autour des centres d’avortement, afin d’éviter qu’on ne sache si des femmes s’y étaient rendues. Pourtant, il s’est avéré que Google n’a pas supprimé ces données comme annoncé. En vertu du Patriot Act ou de certaines décisions judiciaires, il est en effet possible d’obtenir des informations pour savoir si des femmes se sont rendues dans des cliniques d’avortement ou non.
Ainsi, quand les femmes ne sont pas incluses dans les données, elles sont invisibles. Mais lorsqu’elles y figurent, ces données peuvent être utilisées pour contrôler leur corps. Voilà un exemple sinistre de ce phénomène.
Françoise F. Laot. Tu as beaucoup travaillé sur la formation des hommes et des femmes, notamment dans le domaine de l’informatique. Pourrais-tu résumer les principaux enseignements de tes recherches ?
Isabelle Collet. Mes recherches se sont inscrites dans la continuité de celles de Nicole Mosconi. Les travaux en sciences de l’éducation réalisés depuis les années 1980 ont montré que garçons et filles ne vivaient pas la même expérience scolaire. Nicole Mosconi, ainsi que d’autres chercheuses et chercheurs des années 1980-1990, telles que Duru-Bellat, Baudelot, Establet, Felouzis et bien d’autres ont travaillé sur ces questions. Certains travaux ont porté sur les manuels scolaires, révélant une représentation déséquilibrée des sexes, avec une surreprésentation des hommes et des garçons accomplissant des actions, et une sous-représentation des femmes, souvent confinées à des rôles de mères au foyer. D’autres recherches ont porté sur la prise de parole en classe où il a été constaté que les garçons, en moyenne, prenaient deux fois plus la parole que les filles, une tendance particulièrement marquée au niveau secondaire, comme le montre Annette Jarlégan. Il y a également eu des études sur la transmission des savoirs, qui ont montré une prédominance du masculin dans les contenus enseignés, sans que les enseignant·es n’en aient conscience, bien qu’ils et elles soient sincèrement convaincus de dispenser un cours égalitaire.
Le centre Hubertine Auclert, en région parisienne, a mené une étude approfondie sur les livres d’apprentissage de la lecture. Elle montre, dans les années 2010, que deux fois plus d’hommes que de femmes étaient représentés dans ces livres, et les rôles étaient loin d’être égaux. Il est évident que la société a évolué. Aujourd’hui, les femmes font des études et réussissent mieux que les garçons dans presque toutes les disciplines, et ce, jusqu’à la fin du secondaire. Mais cela ne signifie pas qu’elles tirent un bénéfice réel de cette réussite lorsqu’elles entrent dans le monde du travail. De plus, cela ne veut pas dire que les vécus scolaires sont les mêmes pour tous. Il ne faut pas oublier que des inégalités persistent aussi du côté des garçons. En effet, si l’on constate que davantage de garçons décrochent scolairement, c’est aussi à cause du système de genre.
Pour un garçon, réussir à l’école peut être perçu comme dévalorisant. Il doit en quelque sorte prétendre qu’il ne travaille pas, sous peine d’être traité de manière péjorative par ses pairs. Dans certains milieux populaires, la mise en scène de la virilité, la résistance physique à la douleur et la mise en avant de la masculinité sont perçues comme des alternatives à la réussite scolaire. C’est le même système de genre qui, d’une part, nuit à la confiance des filles et à leur persévérance, et d’autre part, empêche certains garçons de s’épanouir pleinement dans leurs études.
Lors de mes premières recherches, j’ai exploré les représentations de l’informatique et les fantasmes autour de cette discipline, en me demandant pourquoi autant de garçons s’étaient enthousiasmés pour l’informatique alors que si peu de filles s’y intéressaient. À l’époque, ce sujet n’intéressait personne, sauf ma directrice de thèse. J’ai donc dû me tourner vers un autre sujet si je voulais espérer obtenir un poste universitaire. C’est ainsi que j’ai commencé à travailler sur les questions de la mixité dans les établissements scolaires. On entendait souvent que, dans les années 1970, des inégalités existaient, mais qu’aujourd’hui, elles avaient disparu. Pourtant, quand on forme des enseignant·es, il est nécessaire de leur prouver que les inégalités sont encore présentes, car beaucoup croient que l’égalité a déjà été atteinte et qu’il ne reste à prendre en compte que les différences biologiques entre les sexes. Typiquement, lorsque l’on dit aux élèves que les métiers n’ont pas de sexe et qu’ils peuvent choisir n’importe quelle carrière, ils ne nous croient pas. Ils observent autour d’eux et constatent que ce n’est manifestement pas vrai. Dans ce contexte, il faut prouver que les différences observées ne sont pas biologiques et que l’égalité n’est pas encore atteinte. Ainsi, réactualiser certaines recherches est loin d’être inutile. Lorsque je suis arrivée à Genève, j’ai réalisé des enquêtes dans les classes. Avant de décrocher mon poste, j’ai travaillé sur la violence de genre dans des établissements secondaires de la région parisienne pour montrer que les contextes scolaires étaient loin d’être égalitaires.
Françoise F. Laot. S’agissant de l’orientation dans l’enseignement supérieur, si l’on en croit les chiffres, aujourd’hui, ce sont les filières informatiques dans les IUT et les BTS qui sont les moins féminisées…
Isabelle Collet. Une question qui revient régulièrement lors de mes conférences est la suivante : « Pourquoi insiste-t-on pour qu’il y ait plus de filles dans l’informatique ou les sciences, mais on ne fait pas autant d’efforts pour attirer des garçons vers les métiers de la petite enfance ou de l’enseignement ? » En réalité, c’est quasiment la même question, et je suis d’accord qu’il faudrait traiter ces deux enjeux avec la même importance. Cependant, il y a une certaine schizophrénie dans notre approche : d’un côté, on affirme que les filles devraient avoir accès à tous les métiers, mais de l’autre, on semble encore considérer que certains métiers restent trop féminins pour y orienter les garçons.
Logiquement, il faudrait effectivement mettre le même effort pour promouvoir la mixité, tant pour les filles dans les métiers où elles sont peu présentes, que pour les garçons dans ceux où ils sont sous-représentés. Toutefois, il est plus facile de « vendre » les métiers techniques aux filles. Ces métiers offrent des carrières valorisantes, des perspectives d’emploi, des salaires attractifs et une reconnaissance sociale. En revanche, promouvoir les métiers du soin, de l’éducation ou du care auprès des garçons est bien plus complexe. Ces professions souffrent d’un manque de reconnaissance, sont mal rémunérées, et offrent souvent des contrats précaires ou des temps partiels. En d’autres termes, il est difficile de rendre ces métiers attractifs.
Je termine parfois en disant, un peu ironiquement, « on ne va pas attirer les mouches avec du vinaigre », mais cela reflète bien la complexité de la situation. Malgré tout, je pense qu’il est essentiel que les enseignant·es, au-delà du fait que c’est objectivement compliqué, adoptent une posture d’égalité dans toutes les disciplines, sans exception. Cela permet de montrer aux filles qu’elles ne sont pas dans un régime à part et, de la même manière, aux garçons qu’ils ne sont pas soumis à des attentes différentes.
Dans le cadre de mon travail, j’ai formé de nombreux enseignant·es sur ces questions d’égalité. Même si mon poste était lié à cette mission, et je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur les dimensions techniques ou spécifiques à certaines disciplines. Cela dit, avec l’ouverture de nouvelles filières informatiques et la demande croissante de professeurs en sciences informatiques dans les établissements scolaires, je suis désormais plus souvent sollicitée pour aborder spécifiquement la question de l’attraction, de l’engagement et du maintien des filles dans ces filières.
Les filles scientifiques très performantes s’orientent vers des écoles d’ingénieurs où elles atteignent 30 %, éventuellement dans des filières liées à l’informatique. Cela reste cependant rare. Parmi les écoles d’ingénieurs reconnues qui investissent des efforts considérables pour promouvoir la mixité, certaines atteignent péniblement un taux de 20 % de filles.
En revanche, dans les formations techniques de niveau IUT et BTS, les chiffres sont encore plus faibles : les pourcentages de filles y sont souvent bien en dessous de 10 %, voire parfois proches de 0. Cela s’explique en partie par la forte proportion de garçons dans ces filières, qui agit comme un véritable repoussoir. Plus les garçons sont nombreux dans ces formations, plus les filles tendent à choisir d’autres options.
Françoise F. Laot. Tu as, toi-même, fait une formation initiale à l’informatique en IUT. Est-ce que cette expérience a joué un rôle de déclic dans tes choix des objets de recherche par la suite ?
Isabelle Collet. Je peux commencer par évoquer mon propre parcours. J’ai appris à programmer à 14 ans grâce à mon père, passionné d’informatique. Ne disposant pas de fils, il partageait naturellement ses intérêts avec ses deux filles. L’informatique était pour lui une fascination, et pour moi, un jeu. Nous programmions ensemble, et cela est resté une activité ludique pour moi tout au long du secondaire.
Dans ma famille, il y avait deux métiers emblématiques, soit médecin, soit ingénieur. Médecine me rebutait à cause du bizutage, un choix sûrement influencé par des considérations genrées. Ingénieur semblait plus accessible, d’autant que ma sœur avait suivi cette voie. Cependant, je n’ai pas réussi à y entrer et je me suis orientée vers un IUT d’informatique. Cette formation m’a paru facile, en partie grâce à l’avance acquise en programmant avec mon père.
À l’époque, les filles représentaient environ un quart des effectifs en IUT d’informatique, une proportion modeste mais pas marginale. Nous avions conscience d’être minoritaires, et il existait une ambiance très masculine. Je me souviens avoir été fière qu’on me considère comme « une pote », je n’étais « pas une vraie fille ». Mais cette fierté m’a poussée à reproduire des comportements excluants envers d’autres filles. Par exemple, en licence de traitement du signal, je valorisais les « vrais informaticiens » (dont je faisais partie) et considérais que certaines filles n’avaient pas leur place dans ce milieu.
Ma perception de l’égalité a changé en entrant dans le monde du travail. Durant mes études, mes compétences étaient respectées, et mon mariage avec un informaticien me plaçait implicitement hors des jeux de séduction. Mais face aux employeurs, j’étais perçue comme une femme en âge d’avoir des enfants, et mes capacités étaient systématiquement remises en question. C’est là où je me suis rendu compte que j’étais une fille, et que ce n’était pas bienvenu dans ce domaine.
Cette période coïncidait avec un ralentissement des embauches en informatique, ce qui a amplifié les difficultés. J’ai trouvé des emplois précaires, mais je n’ai pas trouvé de travail stable avec une perspective de carrière où je ferais des choses intéressantes et où j’avais l’impression qu’on me ferait confiance. Bien que j’aie terminé quatrième de ma licence, j’ai renoncé à poursuivre en master, convaincue à tort d’être à mon maximum. Personne ne m’a encouragée à continuer (même si personne ne m’a découragée non plus) et je n’ai pas envisagé mes notes comme le reflet de mes capacités, alors que les garçons auraient en eux tout ce potentiel.
Si j’ai quitté l’informatique et si j’ai commencé à me poser des questions, c’est d’abord parce que j’ai découvert que la domination masculine existait toujours. Ma mère nous avait bien expliqué qu’elle n’avait pas pu faire les études qu’elle voulait parce qu’elle était femme. Mon père n’avait pas pu faire les études qu’il voulait parce qu’il était ouvrier. Je pensais que, pour ma sœur et moi, cela ne se reproduirait pas et cela nous a protégées durant nos études. Mais le marché du travail a mis à mal cette croyance.
Face aux obstacles, je me suis tournée vers la formation. J’ai commencé par enseigner la programmation, puis des compétences plus générales liées à l’utilisation d’ordinateurs. Lorsque mon mari a été licencié, nous avons déménagé en région parisienne où j’ai décidé de formaliser mon expérience en obtenant un diplôme.
C’est ainsi que je me suis inscrite à l’université de Nanterre pour un master en formation de formateurs. Grâce à ma licence d’informatique, j’ai bénéficié d’équivalences (ancêtre de la VAE) qui m’ont permis d’intégrer directement une maîtrise. Cette nouvelle orientation professionnelle a marqué un tournant, à la fois personnel et intellectuel. À l’université de Nanterre, j’ai découvert deux options de maîtrise : une maîtrise « recherche » et une autre orientée « formation de formateurs », récemment reprise par Philippe Carré. Cette dernière imposait un stage non rémunéré. Après six ans d’expérience dans le domaine, l’idée de faire un stage gratuit me semblait inacceptable. Par défaut, j’ai donc opté pour la maîtrise recherche, bien que je n’avais pas d’équivalences pour y accéder. Ce choix s’est fait presque instinctivement, motivé par le refus du stage, sans réelle compréhension des implications académiques ou professionnelles.
Mon tout premier cours dans cette reprise d’études était en philosophie de l’éducation, un domaine que je ne connaissais qu’à travers les vagues souvenirs de mes cours de philosophie au lycée. Ce jour-là, j’ai râlé en arrivant, irritée par un changement de salle mal annoncé. Mais ce fut une rencontre décisive : le cours était donné par Nicole Mosconi.
Au fil de cette première année, j’ai découvert des enseignements qui abordaient les rapports sociaux de sexe en éducation. Pour moi, c’était un choc intellectuel. La responsable du laboratoire, Nicole Mosconi, était décrite comme féministe, un positionnement qui me semblait alors anachronique et presque incompréhensible. Comment pouvait-on encore être féministe dans les années 2000 ? C’est cette immersion dans les cours et les discussions qui a tout changé. J’ai commencé à relier des expériences de ma vie passée à des mécanismes sociaux plus vastes. J’ai compris pourquoi je m’étais arrêtée à la licence, pourquoi mes compétences avaient été remises en question sur le marché du travail, et pourquoi j’avais été fière qu’on me considère comme « un garçon ». Ce fut un moment de prise de conscience profond, une relecture de mon parcours à travers une nouvelle grille d’analyse.
François F. Laot. En effet, je partage cette expérience avec toi, ayant également eu Nicole Mosconi comme professeure. Elle a aussi profondément marqué mon parcours. Je souhaite revenir avec toi sur la proportion des filles en informatique à l’IUT, une filière où leur présence a significativement diminué avec le temps. Alors que l’on parle souvent de progrès vers l’égalité, ces évolutions montrent qu’il y a, en réalité, des retours en arrière. Comment expliques-tu ce phénomène ?
Isabelle Collet. Lorsque j’ai commencé à réfléchir à un sujet de thèse, mon intérêt se portait sur l’informatique. C’est alors que j’ai constaté un phénomène frappant : à mon époque, les femmes étaient certes minoritaires dans ce domaine, mais autour des années 2000, leur proportion avait encore diminué. Cela allait à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle l’égalité entre les sexes progressait inéluctablement. Cette contradiction a été le point de départ de mes recherches.
En investiguant, j’ai identifié deux phénomènes majeurs. Le premier, qui constitue le cœur de ma thèse, concerne l’arrivée du micro-ordinateur dans les années 1980. Cet outil a radicalement changé la perception de l’informatique. Avant cette période, l’informatique était associée au tertiaire, aux grandes administrations, aux banques, et aux services centraux des entreprises. Elle n’était liée ni à l’industrie ni aux chantiers ni à des métiers stéréotypés masculins. Cela rendait cette filière plus accessible aux femmes, notamment celles issues des sciences, pour qui l’informatique représentait une alternative moins « contre-stéréotypée » que la physique nucléaire ou les mathématiques pures.
De plus, à une époque où les femmes accédaient massivement au monde du travail salarié en entreprise (années 1960 à 1980), l’informatique offrait des opportunités peu verrouillées par une culture masculine du monde ouvrier ou du monde des ingénieurs. On considérait même la programmation, perçue comme un sous-produit de la construction des machines, comme une activité compatible avec les compétences féminines car fondée sur le langage. Et en effet, les femmes sont nombreuses en programmation et notamment dans les IUT, dans les BTS durant les années 1980.
Cependant, l’arrivée du micro-ordinateur a bouleversé ces dynamiques. Ce nouvel outil a favorisé l’émergence d’une culture masculine, dominée par des jeunes garçons passionnés, que l’on qualifierait aujourd’hui de « geeks » ou de « nerds ». Cette culture s’est progressivement refermée sur elle-même, excluant de facto les filles, qui n’avaient ni les mêmes facilités d’accès à ces outils ni les encouragements pour s’y intéresser. Dans le même temps, le micro-ordinateur a fait son entrée en entreprise, renforçant l’idée d’une continuité entre les activités informelles des adolescents et le monde professionnel.
Le deuxième phénomène, que j’ai exploré dans mes travaux, est lié à la montée en puissance des métiers de l’informatique dans la hiérarchie sociale. Comme l’explique Nicole Mosconi dans ses travaux sur la division socio-sexuée des savoirs, plus une compétence gagne en prestige, plus elle tend à se masculiniser. C’est précisément ce qui s’est produit dans l’informatique. À mesure que l’informatique était valorisée socialement et économiquement, les formations dans ce domaine se sont agrandies, attirant une majorité de garçons. Le nombre de femmes, déjà faible, est resté stable, mais en proportion, leur présence a drastiquement diminué.
Ce processus de masculinisation des études en informatique, amorcé dans les années 1980, reste malheureusement d’actualité.
Françoise F. Laot. Aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche ont considérablement enrichi notre compréhension des rapports de genre et des rapports sociaux de sexe, en particulier dans des domaines tels que le travail et la formation. Quelles sont, selon toi, les recherches récentes ou en cours qui abordent la thématique de ce dossier, notamment en lien avec la culture technologique et les techniques ? Y a-t-il également selon toi des pistes de recherche qu’il serait pertinent de développer, en raison de pans encore inexplorés du domaine technique sous cet angle ?
Sur le sujet de l’informatique, je me sens encore très seule. J’ai récemment encadré ma première doctorante, qui a soutenu une thèse sur le rapport genré au numérique des élèves en primaire. Mais sur ce sujet précis, les recherches sont encore à venir. Certes, il existe des recherches sur le rapport au numérique en général, mais sur les interactions genrées des élèves ou des étudiant·es avec le numérique, il n’y a presque rien. Par exemple, dans cette thèse de Lisa Fericelli, on voit que pour les garçons et les filles de 7 à 10 ans, l’interaction avec un ordinateur n’est pas la même. Ce n’est ni catastrophique pour les filles ni idéal pour les garçons, mais c’est différent.
Nous restons trop souvent influencés par le mythe des « digital natives », cette croyance selon laquelle être entouré d’ordinateurs suffirait à savoir les utiliser. C’est absurde. Nous n’avons jamais pensé cela pour d’autres outils. Par exemple, même si la voiture existait déjà quand je suis née, j’ai tout de même dû passer mon permis pour apprendre à la conduire. Mais pour l’ordinateur, on suppose encore que l’usage est intuitif.
Aujourd’hui, je commence à diriger des thèses et à siéger dans des jurys autour de ces questions, mais j’aimerais qu’il y ait davantage de travaux pour enrichir les débats et qu’on me challenge. Cela dit, il existe déjà de nombreuses recherches, notamment sur le numérique éducatif ou les objets numériques dans une perspective anthropologique et sociale. Des chercheurs comme Pascal Plantard, à l’université de Rennes, ont beaucoup contribué à ce domaine. Il faudrait également prendre en compte les différences culturelles : ce problème de sous-représentation des femmes en informatique est très occidental. En Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, même s’il y a des vrais problèmes d’accès aux infrastructures, dans les anciens pays du bloc de l’Est ou en Asie du Sud-Est, les filières sont mixtes. Par exemple, s’il y a une moyenne européenne à 17 %, en Algérie ou en Malaisie elle dépasse les 60 %.
Cela s’explique par des infrastructures différentes, mais aussi par des imaginaires du numérique qui ne sont pas homogènes. Cependant, la domination occidentale reste une constante dans ces recherches et c’est un autre point qu’il faut explorer.
Un événement récent a bouleversé le paysage numérique : l’intelligence artificielle (IA). L’IA soulève des enjeux urgents, et c’est sur ce sujet que je souhaite orienter mes travaux. On parle beaucoup de chat GPT qui impacte les pratiques des enseignant·es, notamment en ce qui concerne l’évaluation, la manière dont on va évaluer, les travaux qu’on demande. Je suis d’accord, mais l’IA ne transforme pas radicalement la forme scolaire. Il faut se demander ce qu’il en est des différences de genre dans le rapport à l’IA ? On a quelques études, mais plutôt réalisées par des instituts de sondage, qui nous montrent que les garçons semblent utiliser davantage ces outils, avoir plus confiance en leur capacité à les aider à apprendre. Mais cela signifie-t-il qu’ils en tirent réellement profit ? Ce n’est pas parce qu’ils ont confiance en l’IA qu’ils apprennent mieux, ni parce qu’ils utilisent plus l’IA qu’ils le font à bon escient. Les premiers résultats suggèrent que les garçons l’utilisent souvent pour tricher, tandis que les filles s’en servent davantage pour se renseigner. Ce constat mérite d’être approfondi.
Un aspect particulièrement ironique est le lien entre l’IA et les devoirs à la maison. Avant, on savait que les devoirs renforçaient les inégalités sociales, mais on ne changeait rien. Maintenant que des outils comme ChatGPT permettent aux élèves moins favorisés de tricher aussi facilement que les autres, on remet en question l’idée même des devoirs. Pourquoi accepte-t-on que les humains aident, mais pas les machines ? Cela soulève des questions sur nos valeurs et notre rapport à la technologie.
Par ailleurs, il serait utile d’étudier les effets de l’IA selon les classes sociales et le genre. Quels métiers seront réellement impactés ? Dans l’éducation, par exemple, les IA sont souvent perçues comme une menace pour les enseignant·es. Cette crainte n’est pas nouvelle : depuis la télévision éducative jusqu’aux MOOC, on a régulièrement annoncé la fin de l’enseignement traditionnel. Pourtant, ces outils n’ont jamais remplacé le face-à-face pédagogique.
Cela dit, certaines évolutions sont envisageables. Il existe des exerciseurs qui utilisent l’IA en mathématiques pour s’adapter aux besoins et progrès des élèves. Dans des contextes où les enseignant·es de mathématiques manquent cruellement, on pourrait imaginer des écoles avec très peu d’enseignant·es et beaucoup d’assistant·es pédagogiques de mathématiques travaillant avec des exerciseurs. Mais cela pose des questions. Premièrement, les filles semblent parfois mieux réussir lorsqu’elles travaillent seules, sans subir la pression des regards ou la menace des stéréotypes. Si l’IA permet de réduire ces pressions, cela pourrait être bénéfique pour elles. Cela dit, je préférais évidemment qu’on investisse dans la formation des enseignant·es sur les questions de genre plutôt qu’on investisse dans l’IA. Deuxièmement, les IA risquent d’être déployées par des hiérarchies souvent masculines pour contrôler et piloter une profession largement féminisée. Cela soulève des questions importantes sur les rapports de pouvoir et la professionnalisation des individus. Ces défis appellent des recherches rigoureuses et une réflexion collective. Nous devons éviter de jouer les apprentis sorciers avec l’IA sans mesurer ses effets à long terme.
Françoise F. Laot. Tu évoques des pistes intéressantes dans le domaine de l’informatique. Vois-tu dans d’autres domaines technologiques des sujets qu’il pourrait être aussi intéressants à développer ?
Isabelle Collet. La seule chose que je tiens à souligner, étant assez centrée sur l’informatique, c’est qu’il existe des liens essentiels avec les questions de développement durable. En effet, l’informatique dont nous parlons est extrêmement gourmande en énergie. En abordant les réflexions sur l’intelligence artificielle, notamment ses impacts positifs et négatifs sur les sociétés et les individus, il est impossible de traiter ces enjeux sans prendre en compte la consommation d’énergie massive liée à l’IA et à la gestion des données.
De plus, lorsqu’on observe les progrès réalisés en matière de gestion des données, on constate souvent un effet rebond : une réduction de la consommation ne conduit pas à une diminution, mais plutôt à une augmentation de l’utilisation. Ces questions devront être abordées en parallèle de sujets qui ne relèvent pas de mon domaine, mais qui sont néanmoins essentiels. En effet, certaines personnes se consacrent à des problématiques telles que la sobriété informatique.
Françoise F. Laot. Tu affirmes être assez seule dans tes recherches sur l’informatique, mais je pense qu’il en va de même pour la technologie en général. Il y a en effet peu de chercheuses impliquées dans ces domaines, même si, bien entendu, il existe quelques exceptions.
Isabelle Collet. Peu de chercheuses, c’est évident. En revanche, il existe un nombre plus important de chercheurs travaillant sur la technologie en général, les usages du numérique, ou la didactique de l’informatique. Toutefois, les femmes dans ces domaines demeurent peu nombreuses. Parmi les grandes pionnières, on peut citer Josiane Jouët, qui a surtout travaillé sur les usages numériques. À propos des objets culturels et éventuellement numériques, il y a des chercheuses comme Christine Détrez ou Fanny Lignon, qui se sont penchées sur les jeux vidéo. Et bien sûr des Anglo-saxonnes, telles que Donna Harraway, Judy Wajcman, Wendy Faulkner et plus récemment Caroline Criado Perez sur l’invisibilisation des femmes dans les données.
Françoise F. Laot. As-tu travaillé sur la formation des adultes, par exemple sur la formation continue des femmes et des hommes, en ce qui concerne les questions d’informatique ?
Isabelle Collet. J’ai travaillé sur les écoles d’enseignement supérieur et la manière de favoriser l’inclusion, notamment pour augmenter la part des femmes dans le numérique. La formation continue me semble être une voie pragmatique pour cela. En effet, de nombreuses femmes se trouvent dans des métiers qu’elles n’ont pas choisis, ou qui ne correspondent plus à leurs attentes. À un moment de reconversion, plutôt que de leur proposer d’effectuer un travail similaire mais légèrement modifié, pourquoi ne pas leur offrir la possibilité de se tourner vers l’informatique ?
Il existe une croyance selon laquelle pour se lancer dans les sciences, il faut avoir une vocation précoce et une agilité particulière. Cette idée est d’autant plus marquée dans le domaine de l’informatique, où l’on pense que seuls les cerveaux « nouveaux », jeunes et agiles, peuvent y exceller. Cependant, cette image du « garçon qui bidouille » commence à vieillir. En reconversion professionnelle, l’informatique offre de nombreuses opportunités. Mais le véritable défi ne réside pas dans la recherche de personnes à former, mais plutôt dans la volonté des employeurs de prendre des risques en recrutant des profils qui ne correspondent pas à leur idée traditionnelle de l’informatique.
J’ai échangé avec une personne qui travaillait sur la reconversion professionnelle et qui avait tenté de former des femmes en reconversion à l’informatique. Cependant, il avait mis en place des conditions d’accès à la formation continue qui étaient trop strictes pour des femmes âgées de 40 à 50 ans, car elles étaient calquées sur celles destinées à de jeunes hommes sortant d’apprentissage. Ainsi, bien qu’il ait eu la volonté de former des femmes, il n’avait pas pris en compte leurs besoins spécifiques, ce qui a rendu son initiative impraticable. Son échec ne s’expliquait pas par un manque d’intérêt des femmes pour la formation, mais par une inadéquation des conditions proposées. Pourtant, il attribuait cet échec aux femmes elles-mêmes. Alors que je pense que, si l’on souhaite former des femmes, par exemple, à l’esthétique ou à la bureautique, il sera sous-entendu que ces formations devront être adaptées à un public féminin. Ce n’est pas parce qu’elles sont des femmes et qu’elles n’ont pas 20 ans que leur performance sera nécessairement moindre. Ce qui me frappe souvent, c’est que, à mon âge, avec mes cheveux blancs, il m’arrive de voir des gens se précipiter pour m’aider lorsque j’interagis avec un objet électronique, ce qui est assez drôle !
Lorsque quelqu’un me prend un objet des mains, comme mon téléphone, je vois bien ce que cela semble dire : je suis vieille, je suis une femme donc j’ai besoin d’aide. Cet exemple illustre bien les difficultés que nous rencontrons à nous affirmer. Il est évident qu’en formation continue, il y a une réelle opportunité pour accompagner des femmes dans leur reconversion professionnelle, notamment dans des métiers en tension.